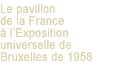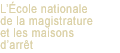En 1946, Guillaume Gillet met
de côté sa passion pour la
peinture au profit de la pratique
de l'architecture, passion qu'il
reprendra dans les années 1980.
Impliqué dans les tentatives de
réformes de l'École nationale des
Beaux-arts de Paris, il dirige,
avec Georges Johannet, un atelier
extérieur de 1953 à 1963, puis
un atelier officiel de 1964 à 1971.
En 1946, Guillaume Gillet met
de côté sa passion pour la
peinture au profit de la pratique
de l'architecture, passion qu'il
reprendra dans les années 1980.
Impliqué dans les tentatives de
réformes de l'École nationale des
Beaux-arts de Paris, il dirige,
avec Georges Johannet, un atelier
extérieur de 1953 à 1963, puis
un atelier officiel de 1964 à 1971.Petit-fils et fils d'académiciens, son entrée à l'Académie des Beaux-arts en 1968, récompense son engagement en faveur des arts et de l'architecture en particulier. Sous la coupole de l'Institut, il prononce les discours de réception de nouveaux membres : Iannis Xenakis, Roger Taillibert, Kenzo Tange, Ieoh Ming Pei.
Il est l'auteur de nombreux articles publiés principalement dans Le Figaro et Les Nouvelles littéraires, le plus souvent sous la forme de lettres ouvertes écrites en réaction à l'actualité de l'époque. Ses prises de positions sont toujours en faveur de la défense de la profession régulièrement attaquée. Il milite pour une architecture pleinement de son époque, déclarant en 1965 « Nous vivons un âge d'or de l'architecture ».
Les archives de Guillaume Gillet
 Par testament, Guillaume Gillet a fait don aux Archives nationales des maquettes et des plans de ses projets et réalisations. En 1990, sa famille a proposé une dation des pièces écrites (correspondance professionnelle et personnelle, dossiers d'exécution, écrits personnels, etc.).
Par testament, Guillaume Gillet a fait don aux Archives nationales des maquettes et des plans de ses projets et réalisations. En 1990, sa famille a proposé une dation des pièces écrites (correspondance professionnelle et personnelle, dossiers d'exécution, écrits personnels, etc.).Il s'agit d'un des rares exemples d'archives d'architecte ayant fait l'objet d'une dation de l'État. Des compléments successifs sont venus se rajouter au versement initial des plans en 1991, 1996, 2005 et 2007.
Le fonds Gillet est un des ensembles les plus complets d'archives d'un architecte et de son agence. Un grand nombre de pièces écrites sont des pièces personnelles ou des pièces d'agence qui permettent de comprendre la culture, les relations de l'architecte, ses préoccupations, mais également le fonctionnement d'une des agences les plus importantes de la période 1945-1975., notamment les relations avec et entre les différents collaborateurs.
Le classement en cours des archives met en lumière toute l'œuvre de l'architecte, mais également l'importance de l'homme, et la position qu'il occupe dans l'histoire de l'architecture des Trente Glorieuses. Gillet illustre certains aspects de la profession comme la collaboration architecte-ingénieur, trop souvent présentée comme une confrontation, mais aussi l'implication des professionnels dans la formation des futurs architectes. Des rapprochements intéressants et significatifs pourraient être faits avec d'autres personnalités comme Louis Arretche, Henry Bernard, ou bien encore Bernard Zehrfuss dont les archives sont aussi conservées à la Cité de l'architecture et du patrimoine.